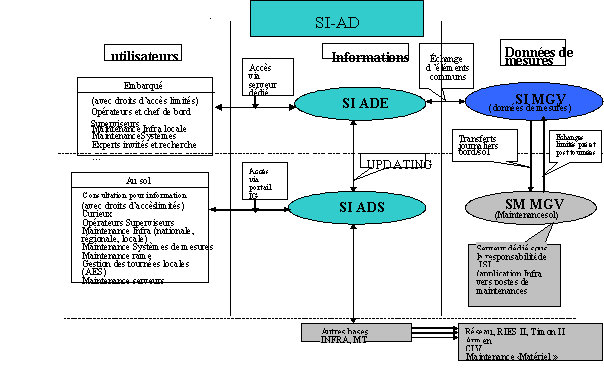V . PRESENTATION DU PROJET MGV
Le projet MGV utilise des compétences de nombreux domaines d’expertise au travers de ses activités de mesures diverses. En effet, le MGV, rame TGV complète, composée de huit voitures et de deux motrices, transformée en outil de mesures reprend quatre domaines de l’Infrastructure : les voies, la signalisation, les caténaires et les télécommunications. Aux systèmes et capteurs novateurs – vitesse de 320 km/h -, s’ajoutent des éléments complémentaires tels que l’informatique embarquée destinée à la gestion des données et au déploiement de la rame.
La rame MGV représente un investissement de 33,5 millions d’euros répartis sur différents lots, correspondant à l’acquisition, l’aménagement et l’intégration des équipements.
5.1. Les engins de surveillance existantAujourd’hui, plusieurs engins équipés de systèmes de mesures effectuent des tournées sur les infrastructures ferroviaires afin d'assurer la détection des points susceptibles de compromettre la sécurité et la régularité de la circulation ainsi que le confort des voyageurs.
A l'heure actuelle, chacun de ces engins contrôle un type d'installations bien particulier : les voitures ‘Mauzin’ qualifient la géométrie de la voie. Les voitures ‘Hélène’ et ‘IES’, quant à elles, contrôlent les installations de signalisation et de télécommunications appartenant à la SNCF. Ces voitures circulent à des vitesses ne dépassant pas 160 ou 200 km/h.
Un seul de ces véhicules, la voiture ‘Mélusine’, peut rouler à 320 km/h. Cette voiture contrôle les interactions véhicule-voie sur les lignes à grande vitesse (mesures d’accélération à vitesse de ligne). Il s'agit d'une remorque TGV instrumentée et insérée dans une rame complète de TGV classique de manière à reproduire la dynamique d'une circulation normale sur la voie.
Ces voitures utilisent de nombreux sillons (un sillon correspond à un trajet de train planifié à vitesse maximale de ligne) sur des lignes déjà saturées ou circulent à des heures nocturnes empêchant alors les techniciens de maintenance de travailler sur les voies empruntées. On comprend alors l'intérêt de la mise en place d’un seul et unique outil rapide et capable de valider la circulation sur les voies à grande vitesse.
5.2. Le besoinDans le cadre de sa mission de gérant des infrastructures, la SNCF souhaite mettre en place une politique de maintenance préventive puis prédictive pour, d’une part, optimiser les opérations d’entretien pour en réduire le coût sans nuire à la sécurité des circulations et, d’autre part, améliorer le confort ainsi que la régularité en réduisant le nombre d’incidents. Une des voies envisageables est d’améliorer la qualité et d’augmenter la fréquence des auscultations par les engins de surveillance.Par ailleurs, la quasi-saturation de certaines portions du réseau nécessite de limiter le nombre de sillons affectés aux engins de contrôle des installations pour ne pas empiéter sur les intervalles dévolus à la maintenance.Enfin, les engins de contrôle disponibles ne permettent pas de répondre à l’extension du réseau ferré à grande vitesse (ligne du TGV Est).
Dans ce contexte, l’Infrastructure a commandité le projet "Mesures à Grande Vitesse" (MGV), rame TGV dédiée à la mesure en vitesse de ligne - jusqu’à 320 km/h - et fédérant les différents systèmes de surveillance des installations ferroviaires, actuellement répartis sur les différents engins des métiers "voie, signalisation, caténaires et télécommunications".
IG est en charge de l'étude, de l'aménagement, de l'équipement et du déploiement de cette rame. Les objectifs sont d’ausculter bi mensuellement l’ensemble des lignes à grande vitesse et, trimestriellement, les voies principales du réseau classique.Le MGV doit assurer la mesure et les traitements des données en temps réel et transmettre, après validation à bord en temps faiblement différé, ces indicateurs de l’état et des performances des équipements "terrain" vers les centres de maintenance au niveau local, régional et national. Par ailleurs, il est important que les mesures soient fiables pour garantir la sécurité tout en limitant les interventions sur le terrain.
5.3. Fonctionnement de la rame MGVLa rame MGV circulera 48 semaines par an, du lundi au vendredi avec un retour hebdomadaire vers son atelier de maintenance. La rame de mesures à grande vitesse inspectera deux fois par mois la totalité des lignes à grande vitesse et quatre fois par an les principales lignes classiques.
Pour mener à bien ces missions, l’équipage composé de 6 spécialistes et d’un chef de bord, disposera des commodités nécessaires pour parcourir les lignes durant une semaine de manière autonome. Certains postes sont réservés aux responsables de la maintenance locale ou à des experts conduisant des travaux de recherche : mise au point de nouveaux équipements de mesures ou qualification de matériels ferroviaires.
5.4. Systèmes de mesuresA bord, des systèmes de mesures permettront de mesurer la géométrie de la voie, le comportement dynamique de la rame, les conditions et la qualité du captage du courant de la caténaire, la couverture du réseau des télécommunications de la SNCF, et de tester le bon fonctionnement des différentes installations de sécurité. Tous les outils de contrôle seront reliés à des ordinateurs embarqués qui qualifieront les installations en fonction de critères préalablement enregistrés. Des traitements embarqués fourniront une analyse synthétique de ces données, vérifieront l'existence de dépassements de seuils critiques et permettront une visualisation comparative avec la tournée précédente. Les spécialistes présents à bord feront une première exploitation des données. Le soir, les constats seront adressés aux unités de maintenance concernées. Après une phase de tests, le MGV effectuera normalement ses premières mesures mi-2005.
5.5. Les systèmes informatiques à bord du MGVLe système informatique du MGV est composé de deux «sous-systèmes» principaux: le SI-MGV et le SI-AD.
Le SI-MGV (Système Informatique pour le MGV) est conçu pour la collecte des données issues des équipements embarqués chargés de faire des mesures dans les domaines particuliers du contexte ferroviaire évoqués plus haut (voie, caténaire, signalisation et télécoms). Il doit aussi permettre aux utilisateurs à bord de visualiser en temps réel ces mesures sur leur poste de travail, de les interpréter, et de réaliser les traitements adéquats.
Le schéma général donné ci dessous montre la place du système informatique au centre du dispositif embarqué:
Figure 4: Le SI-MGV
Cependant, les besoins d’informations ne peuvent se réduire à la gestion des données de mesures, ne serait ce que parce qu’à bord, des hommes et du matériel devront cohabiter et c’est là que le SI-AD vient prendre le relais.
Le SI-AD (Système Informatique d’Archivage Dynamique) gère tout ce qui ne concerne pas les mesures. Il est en charge de la gestion de la logistique et de la maintenance de la rame et des systèmes. Il gère tous les paramètres concourrant à la bonne réalisation des tournées et permet d’effectuer des opérations transverses à plusieurs tournées. C’est un outil d’aide à la décision et de gestion documentaire. Il prend par ailleurs en charge la mise à jour des documents et informations utilisés à bord.
Ces interactions entre les différents systèmes informatiques sont résumées par le schéma suivant:
Figure 5: Interactions entre les systèmes informatiques du MGV